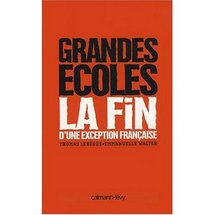Le titre de l’ouvrage laisse entendre que les Grandes Ecoles, c’est fini. Dans la veine de Faut-il sauver les grandes écoles ? de Pierre Veltz paru l’an passé, les deux enquêteurs tirent à boulets rouges sur ces écoles qui sont « trop petites, trop sclérosées, pas assez ouvertes socialement » et qui détournent leurs élèves de la recherche. Ces établissements seraient donc promis à une mort lente mais inéluctable s’ils n’évoluent pas, dans un enseignement supérieur qui a pris une dimension mondiale. Tel est le fil conducteur de cet ouvrage, fruit d’une minutieuse enquête journalistique, riche en exemples et citations.
Endogamie et non-sens économique
Les auteurs cherchent d'abord à démontrer le non-sens économique que constitue le système français des grandes écoles. Celui-ci accrédite en effet une micro-élite qui se serre les coudes à la tête des grandes entreprises et ne s’ouvre pas aux talents extérieurs ni ne se remet en cause. Soit « une France qui tourne en rond depuis trente ans au sommet du pouvoir, loin, très loin des cohortes sorties de l’université ». À la Société Générale, dans les salles de marché, les traders sont pratiquement tous diplômés de quatre grandes écoles d’ingénieurs parisiennes : Les Ponts, Les Mines, Centrale et Polytechnique. L’affaire Kerviel, du nom de ce vilain petit canard universitaire qui a réussi à déjouer les contrôles des génies endogames de la finance, sert de point de départ à leur démonstration. Car quand tout va mal et que des têtes doivent être coupées, on remplace simplement « des X par des X et des énarques par des énarques ». Les Pdg français sont surveillés par des conseils d’administration consanguins dont les membres sont issus des mêmes écoles, des mêmes réseaux. « C’est cette oligarchie qui est largement responsable du marasme économique en France », selon Gilbert Béréziat, le délégué général de Paris Universitas, cité par les deux journalistes.
Et les auteurs de relever que les distorsions concurrentielles sur le marché de l’emploi commencent dès le premier poste : les anciens des grandes écoles ont accès, via leur réseau, aux offres d’emploi cachées, celles qui sont connues uniquement par bouche à oreille. Or, « c’est tout l’inconvénient de la réseaucratie : les relations personnelles priment trop souvent sur la compétence ». Un exemple : « à poste égal, on ne verra jamais un polytechnicien moins bien payé qu’un étudiant d’origine universitaire, quelles que soient leurs performances respectives au sein de l’entreprise ». Quoi de plus démotivant ?
Et les auteurs de relever que les distorsions concurrentielles sur le marché de l’emploi commencent dès le premier poste : les anciens des grandes écoles ont accès, via leur réseau, aux offres d’emploi cachées, celles qui sont connues uniquement par bouche à oreille. Or, « c’est tout l’inconvénient de la réseaucratie : les relations personnelles priment trop souvent sur la compétence ». Un exemple : « à poste égal, on ne verra jamais un polytechnicien moins bien payé qu’un étudiant d’origine universitaire, quelles que soient leurs performances respectives au sein de l’entreprise ». Quoi de plus démotivant ?
Délit d’initiés et secret de famille
La partie la plus passionnante de l’enquête est celle où Lebègue et Walter démontrent à quel point les grandes écoles puisent toujours dans le même vivier, malgré les effets d’annonce. Certes, depuis Bourdieu, on connaît le principe de la reproduction des élites, et l’on trouve chaque année dans la presse des articles sur le sujet, mais les deux journalistes ont su actualiser et relever les contradictions dans le discours que tiennent les grandes écoles sur leur propre évolution.
« Ceux qui réussissent l’oral d’une très grande école sont aussi ceux pour qui c’est normal d’être là », selon Thibaut de Saint-Pol, sociologue interrogé dans l’ouvrage. Les auteurs relèvent également que dans chaque promotion de l’X, de l’ENS ou de l’Ena, il y a un grand nombre de « Filles et Fils de ». « Chaque promotion de l’Ena compte au minimum deux ou trois fils d’énarques – un ratio étonnant quand on sait que l’école forme moins de 100 élèves par an », soulignent-ils.
Le livre contient quelques vérités bien connues, mais toujours frappantes à la lecture : « En France, il n’est pas exagéré de dire que tout est joué à 17 ans. Une mauvaise classe de Première est souvent rédhibitoire pour entrer ensuite en classe prépa ». Il faut pour réussir arriver à « mettre un pied dans l’une de ces très grandes écoles avant l’âge de 21 ans » pour s’assurer d’une place à vie parmi l’élite. Comment rejoindre ces réseaux ? Quand on vit en province, il n’y a pas mille manières : « les grandes capitales régionales n’offrent généralement qu’un établissement public d’élite ». Par exemple : Le Parc à Lyon, Fermat à Toulouse, Thiers à Marseille.
Le plus paradoxal d’ailleurs, comme l’expliquent Lebègue et Walter, c’est que la qualité des grandes écoles repose sur la sélection faite en prépa (laquelle repose sur les résultats du lycée). Les jeunes choisissent leur grande école sur des critères de prestige et d’image et pas du tout sur le contenu de la formation. La cote des établissements eux-mêmes se mesure à leur capacité à attirer des élèves des prépas d’élite, jamais à leur capacité à transformer des étudiants moyens en jeunes diplômés compétents et aptes à faire partie des meilleurs dans l’univers professionnel.
« Ceux qui réussissent l’oral d’une très grande école sont aussi ceux pour qui c’est normal d’être là », selon Thibaut de Saint-Pol, sociologue interrogé dans l’ouvrage. Les auteurs relèvent également que dans chaque promotion de l’X, de l’ENS ou de l’Ena, il y a un grand nombre de « Filles et Fils de ». « Chaque promotion de l’Ena compte au minimum deux ou trois fils d’énarques – un ratio étonnant quand on sait que l’école forme moins de 100 élèves par an », soulignent-ils.
Le livre contient quelques vérités bien connues, mais toujours frappantes à la lecture : « En France, il n’est pas exagéré de dire que tout est joué à 17 ans. Une mauvaise classe de Première est souvent rédhibitoire pour entrer ensuite en classe prépa ». Il faut pour réussir arriver à « mettre un pied dans l’une de ces très grandes écoles avant l’âge de 21 ans » pour s’assurer d’une place à vie parmi l’élite. Comment rejoindre ces réseaux ? Quand on vit en province, il n’y a pas mille manières : « les grandes capitales régionales n’offrent généralement qu’un établissement public d’élite ». Par exemple : Le Parc à Lyon, Fermat à Toulouse, Thiers à Marseille.
Le plus paradoxal d’ailleurs, comme l’expliquent Lebègue et Walter, c’est que la qualité des grandes écoles repose sur la sélection faite en prépa (laquelle repose sur les résultats du lycée). Les jeunes choisissent leur grande école sur des critères de prestige et d’image et pas du tout sur le contenu de la formation. La cote des établissements eux-mêmes se mesure à leur capacité à attirer des élèves des prépas d’élite, jamais à leur capacité à transformer des étudiants moyens en jeunes diplômés compétents et aptes à faire partie des meilleurs dans l’univers professionnel.
Redistribution à l’envers
Que fait l’Etat dans ce contexte ? Il dépense environ 3.500 euros par étudiant en deuxième cycle universitaire de droit ou de sciences économiques, 10.600 euros pour un étudiant en sciences, 13.100 euros pour un étudiant en fac de médecine, mais aussi près de 13.000 euros pour un étudiant en école d’ingénieurs post-bac, 34.900 euros pour un élève dans une école d’ingénieurs accessible après une prépa et jusqu’à près de 40.000 euros pour un élève de Normale Sup ou de l’Ena. Gilbert Béréziat s’interroge : « Pourquoi l’Ecole Polytechnique reçoit de l’Etat trois à quatre fois plus de crédits que la plus grande université de France, Paris VI ? ». Lebègue et Walter se demandent pourquoi l’Ecole normale supérieure bénéficie d’une soulte pour payer ses élèves, à l’image de 22 écoles d’ingénieurs (pour les futurs militaires à Saint-Cyr, l’école navale, l’école de l’air…ou les futurs fonctionnaires à l’école des Mines de Douai ou l’école nationale de météorologie de Toulouse) ou bien encore de l’Ena. Ils relèvent par ailleurs que l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, établissement public géré par une fondation privée (la Fondation Nationale des Sciences Politiques) cumule à la fois les avantages du public (l’IEP est financé par l’Etat) et ceux du privé (il est indépendant pour sa pédagogie et la gestion de son budget). C’est ainsi que Sciences Po peut tout à la fois faire payer à ses étudiants les mêmes frais de scolarité que les écoles de commerce, s’associer à des entreprises pour certains programmes, tout en faisant financer sa recherche et ses enseignants par l’Etat.
Les grandes écoles publiques sont quasiment gratuites alors qu’elles accueillent un public socialement privilégié : c’est ce que les auteurs appellent une « redistribution à l’envers ». Cela signifie que les classes moyennes, dont les enfants étudient à l’université, payent avec leurs impôts une scolarité confortable à des jeunes gens bien nés. Ces dépenses en capital humain servent-elles au moins l’économie française ? Il est permis d’en douter. Les auteurs citent la directrice de l’enseignement de ParisTech qui relève que les plus grandes écoles d’ingénieurs françaises forment aujourd’hui « des traders qui partent à Londres, New-York ou Shanghai ». Polytechnique forme plus de banquiers et de consultants que de chercheurs, mais l’Etat ne semble guère s’en soucier. Il est vrai que les diplômés de Normale ou de Polytechnique auraient tort de se priver : on gagne dix fois plus dans une banque que dans la recherche. Mais pourquoi dans ce cas est-ce au contribuable de financer leurs études ?
Les grandes écoles publiques sont quasiment gratuites alors qu’elles accueillent un public socialement privilégié : c’est ce que les auteurs appellent une « redistribution à l’envers ». Cela signifie que les classes moyennes, dont les enfants étudient à l’université, payent avec leurs impôts une scolarité confortable à des jeunes gens bien nés. Ces dépenses en capital humain servent-elles au moins l’économie française ? Il est permis d’en douter. Les auteurs citent la directrice de l’enseignement de ParisTech qui relève que les plus grandes écoles d’ingénieurs françaises forment aujourd’hui « des traders qui partent à Londres, New-York ou Shanghai ». Polytechnique forme plus de banquiers et de consultants que de chercheurs, mais l’Etat ne semble guère s’en soucier. Il est vrai que les diplômés de Normale ou de Polytechnique auraient tort de se priver : on gagne dix fois plus dans une banque que dans la recherche. Mais pourquoi dans ce cas est-ce au contribuable de financer leurs études ?
Les PRES comme issue de secours
Il y a un happy end au livre de Lebègue et Walter : les grandes écoles peuvent survivre dans le cadre des PRES, ces Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur, qui promettent de réunir universités et grandes écoles dans un même ensemble. Car au fond, qu’est-ce qu’un bon établissement d’enseignement supérieur ? s’interrogent les auteurs. Ils laissent à Bernard Bobe, l’ex-délégué général de ParisTech, le soin de répondre : « C’est un établissement multidisciplinaire, autonome, situé dans un périmètre géographique restreint, avec un bon volume de chercheurs, qui comprend de 10 000 à 30 000 étudiants, voire plus, et qui forme et mélange tout le monde : des futurs chercheurs, des futurs cadres moyens, des futurs élites ».
Les deux journalistes ajoutent : « un bon établissement permet à tous les types d’étudiants de profiter des bons profs et des bons labos. Il n’érige pas de cordon sanitaire entre les filières d’élite et les autres. Il autorise l’étudiant à changer de domaine de formation au cours de ses études, sans tout reprendre à zéro. Il n’oblige pas à choisir à l’âge de 18 ans son destin professionnel (…) ». En clair, si l’on comprend bien ce que les auteurs de « Grandes Ecoles - La fin d’une exception française » ont voulu dire, un bon établissement, cela pourrait être une université américaine, puisque ces dernières répondent presque point par point à la définition de l’établissement idéal qu’ils proposent.
Au final, l’ouvrage récemment paru aux éditions Calmann-Levy, de fort bonne facture, ne porte peut-être pas le titre le plus approprié. Car ce n’est pas tout à fait de la fin des grandes écoles dont il est question, mais plutôt de leurs défauts. Les auteurs écrivent que celles-ci traversent « une crise d’identité et de légitimité » et que « beaucoup de directeurs et d’anciens élèves ont bien conscience d’arriver à la fin d’un cycle ». Mais au terme de la lecture, si l’on a appris une foule de choses sur les dessous de la sélection sociale des grandes écoles, l’aberration économique que représentent leurs réseaux et leur financement, on ne sait pas sur quoi débouche la fin du cycle annoncée.
On comprend bien que l’Ena doit se réformer – c’est désormais sur les rails depuis la sortie du livre – et que les plus petites écoles d’ingénieurs sont condamnées à se regrouper ou à intégrer l’université pour celles qui n’en faisaient pas partie, mais on ne voit pas pourquoi toutes les grandes écoles, et celles de commerce notamment (dont la stratégie est peu remise en question, tout comme dans le livre de Pierre Veltz), sont en train de vivre leurs derniers instants, comme le suggère le titre de l’ouvrage.
Les deux journalistes ajoutent : « un bon établissement permet à tous les types d’étudiants de profiter des bons profs et des bons labos. Il n’érige pas de cordon sanitaire entre les filières d’élite et les autres. Il autorise l’étudiant à changer de domaine de formation au cours de ses études, sans tout reprendre à zéro. Il n’oblige pas à choisir à l’âge de 18 ans son destin professionnel (…) ». En clair, si l’on comprend bien ce que les auteurs de « Grandes Ecoles - La fin d’une exception française » ont voulu dire, un bon établissement, cela pourrait être une université américaine, puisque ces dernières répondent presque point par point à la définition de l’établissement idéal qu’ils proposent.
Au final, l’ouvrage récemment paru aux éditions Calmann-Levy, de fort bonne facture, ne porte peut-être pas le titre le plus approprié. Car ce n’est pas tout à fait de la fin des grandes écoles dont il est question, mais plutôt de leurs défauts. Les auteurs écrivent que celles-ci traversent « une crise d’identité et de légitimité » et que « beaucoup de directeurs et d’anciens élèves ont bien conscience d’arriver à la fin d’un cycle ». Mais au terme de la lecture, si l’on a appris une foule de choses sur les dessous de la sélection sociale des grandes écoles, l’aberration économique que représentent leurs réseaux et leur financement, on ne sait pas sur quoi débouche la fin du cycle annoncée.
On comprend bien que l’Ena doit se réformer – c’est désormais sur les rails depuis la sortie du livre – et que les plus petites écoles d’ingénieurs sont condamnées à se regrouper ou à intégrer l’université pour celles qui n’en faisaient pas partie, mais on ne voit pas pourquoi toutes les grandes écoles, et celles de commerce notamment (dont la stratégie est peu remise en question, tout comme dans le livre de Pierre Veltz), sont en train de vivre leurs derniers instants, comme le suggère le titre de l’ouvrage.

 Vie universitaire
Vie universitaire Grandes Ecoles, la fin d’une exception française
Grandes Ecoles, la fin d’une exception française